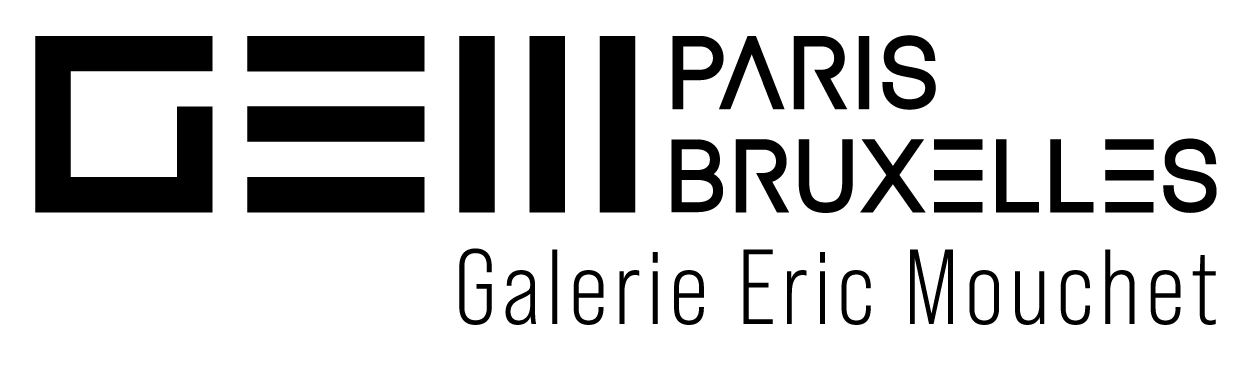Paris Calligrammes – Ulrike Ottinger
Paris Calligrammes – Ulrike Ottinger
Ulrike Ottinger, Aller toujours retour
Dans Aller jamais retour (Bildnis einer Trinkerin, 1979), premier film de la trilogie berlinoise d’Ulrike Ottinger, cinéaste, plasticienne et photographe allemande née en 1942, Tabea Blumenschein interprète une femme mutique qui chaque jour s’habille somptueusement pour se saouler jusqu’à l’épuisement. Cette fascinante fuite en avant à travers les endroits les plus divers et banals de la capitale ouest-allemande prend la forme d’une dérive dont la destination précise semble peu importer, tant qu’elle offre un débit de boissons. Le parcours de sa protagoniste, les yeux écarquillés à l’arrière d’un taxi ou claudicante sur ses talons hauts, apparait d’une liberté absolue. Le lâcher prise est cinglant, total, au parfait mépris des convenances sociales qu’un trio radoteur se charge d’ailleurs de rappeler.
Ulrike Ottinger inscrit son dernier film, Paris Caligrammes (2019), dans cette longue tradition littéraire – Walter Benjamin n’est jamais loin – et artistique. Remarquablement séquencée, la narration serpente, mêle les époques et les lieux : Paris d’hier et d’aujourd’hui, Paris pluriel et singulier. Autobiographique, le récit est d’abord celui des rencontres artistiques et des découvertes culturelles faites par son autrice dans la ville lumière. De son arrivée à Paris en 1962, à tout juste vingt ans, à son retour en Allemagne de l’Ouest en 1969, Ulrike Ottinger vit sept années fondatrices, dont la richesse nourrira en profondeur sa pratique. La porte d’entrée vers les souvenirs s’ouvre rue du Dragon dans le 6e au seuil de la Librairie Calligrammes.
La promenade tissée d’images d’archives et de prises de vue contemporaines semble parfois prendre des allures de carte postale – la vie germanopratine ; l’animation des cafés et des clubs ; la fréquentation assidue de la Cinémathèque française à Chaillot, qui lui donne le goût du cinéma ; les cours de Bourdieu, Lévi-Strauss et Althusser à la Sorbonne ; les salles désertes du musée Gustave Moreau et les trésors du Louvre. Mais l’ambivalence règne, à l’image des contradictions de l’époque. Après la seconde Guerre mondiale, l’heure est à l’optimisme et le progrès parait sans limite. Les innovations techniques bouleversent les intérieurs domestiques et les limites du monde connu, la consommation est encouragée par des publicités joyeuses et colorées. Pour autant, le monde est agité par les conflits liés à la décolonisation. Les Accords d’Évian mettant fin à la guerre d’Algérie sont signés l’année de l’arrivée d’Ottinger en France, qui voit dans les vestiges des pavillons du Jardin d’agronomie tropicale, dans une vente à l’Hôtel Drouot ou dans les salons de coiffures du Faubourg Saint-Denis, autant de témoignages du passé colonial français. Entre conservatisme et aspirations libertaires, la décennie mène aux heurts politiques de mai 1968 : Ulrike Ottinger quittera Paris quelques mois plus tard.
De la plasticienne à la cinéaste, et retour
Arrivée à Paris en jeune plasticienne (elle a étudié la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Munich), Ulrike Ottinger en repart en future cinéaste. Entre temps, elle sera passée de la gravure – les aquatintes à l’imagerie symbolique de la série Israël, qu’elle réalise au sein de l’atelier de Johnny Friedlaender et montre chez Fritz Picard, lui valent de premières critiques élogieuses – à une pratique picturale empruntant au langage coloré de la Figuration narrative, l’équivalent français du Pop Art américain. Elle réalise notamment des peintures sur différents panneaux qui, une fois assemblés, renvoient à la forme classique du retable. Leur narration rappelle parfois l’organisation en vignettes des comics, à l’instar du bien nommé tableau onirique Bande dessinée (1966). Les bulles de dialogue vides sont des motifs récurrents, comme dans les sérigraphies Journée d’un GI (1967), dont les cases alternent différents moments du quotidien d’un soldat américain, ou dans son grand tableau en forme de puzzle Allen Ginsberg (1965), où le poète Beat est grimé en Oncle Sam.
Marie Chênel
Category:
Expositions
Ulrike Ottinger, Bubblegum, 1966 100×100 cm Acrylique sur toile

Ulrike Ottinger_Bubblegum 1 of 4_1966_100x100cm_acrylic on canvas_

Ulrike Ottinger, journée d’un GI, tapisserie

Ulrike Ottinger_Untitled_1967_60x84cm_Serigraph

Ulrike Ottinger_Untitled_1967_82x60cm_Serigraph

Ulrike Ottinger, Allen Ginsberg, 2018,150 x 207 cm, tapisserie