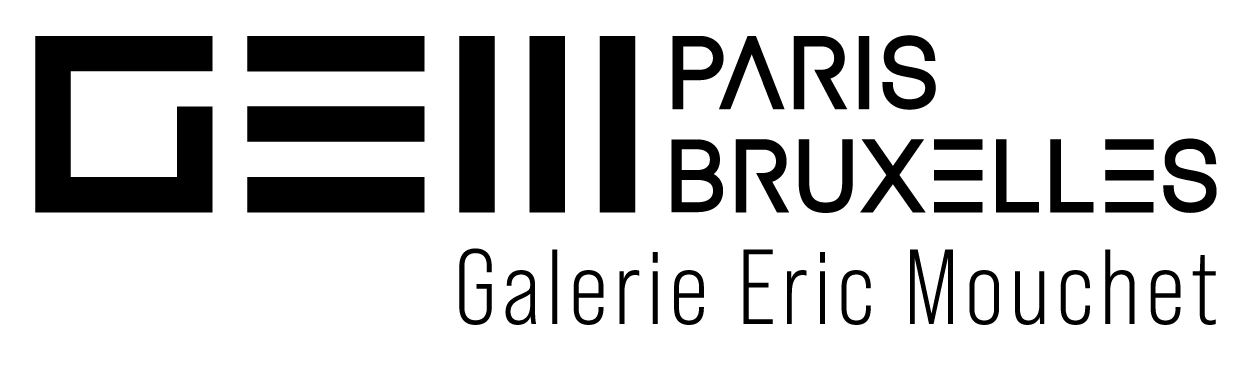T* – Remi dal Negro
T* – Remi dal Negro
Gaël Charbau. : Pour commencer par une note biographique, j’aimerais savoir ce qui t’a donné envie de rentrer dans une école des Beaux-Arts, alors que tu étais musicien?
Rémi Dal Negro : Je crois que j’ai toujours dessiné. Curieusement, je n’ai pas été en contact dans ma jeunesse avec les arts visuels et personne ne m’a influencé dans ma famille. Je viens d’un environnement très modeste et j’ai décidé de partir très tôt à l’aventure, pour découvrir d’autres horizons. La musique a été pour moi un révélateur du monde qui m’a effectivement conduit à me tourner vers les Beaux-Arts, parce que je ne voyais pas arriver autre chose. C’était bien là que je sentais les choses. J’ai arrêté la musique classique et la pratique du piano vers seize ans, pour me tourner vers la basse, que je n’ai jamais utilisé comme une basse, tout comme la trompette! J’ai exploré la mouvance post-punk en « bricolant » ces instruments… J’avais visité plusieurs écoles d’art pour poursuivre mes études et je me suis dit que c’était exactement le type d’espaces qui m’intéressait, où j’allais avoir à disposition une multitudes d’outils qu’il me fallait investir.
G.C. : L’école d’art était-elle pour toi un des rares endroits où l’on peut expérimenter librement au quotidien?
R.D.N. :C’est juste. Il y avait déjà beaucoup de spontanéité dans mes créations sonores à l’époque, déjà plus aucune partition. L’expérimentation était très valorisée à l’école d’art d’Annecy, et c’était pour moi un heureux hasard… J’ai décidé par moi-même de suivre cette voie, dans une forme d’évidence, indépendante de mon entourage. Le jour où j’ai visité l’école, je me suis dit que c’était exactement ce dont j’avais besoin. J’avais besoin de créer une rupture dans ma vie, avec une certaine tradition « vieille école » dont j’étais imprégné. L’école avait établi un partenariat avec le conservatoire de musique d’Annecy, dans le domaine de l’électro-acoustique. Cela m’a permis de suivre dans une école d’art les modules d’un enseignement basé sur les machines et les programmes.
Gaël Charbau : Si tu devais résumer aujourd’hui ton travail en quelques mots, quel serait le concept que tu mettrais en avant ?
Rémi Dal Negro : Je pense que mon œuvre, depuis ces dernières années, est une exploration systématique de l’espace et du temps. Et dans ce binôme espace / temps, c’est le temps qui m’intéresse certainement le plus, car c’est une notion plurielle : on parle du temps numérique, du temps photographique, du temps mécanique…
G.C. : Un temps que tu as donc toujours conjugué en gardant dans tes pièces la présence de la pratique musicale…
R.D.N. : Oui, je dirais que les choses se sont imbriquées assez naturellement, depuis la musique classique jusqu’aux beaux-arts. Cette relation art plastiques et musique a toujours été omniprésente dans mes recherches et même aujourd’hui, dans ma pratique photographique, j’y vois des rapports. Le son dans l’écoute, c’est vraiment un moment de pur présent.
G.C. : Ce temps matérialisé, découpé, énoncé… C’est une notion complexe à définir, comment essayes-tu de le rendre tangible dans tes pièces?
R.D.N. : Comme tout le monde, je pense que le rapport que j’ai au temps est très perceptif. On peut isoler énormément de formes tangibles de ce temps, des sensations, des temps parallèles. J’ai remarqué que je savais toujours quelle heure il était, que ce soit le jour ou la nuit! Je dois avoir une espèce d’horloge interne, calée sur le temps du cadran. Mais en même temps, dans cette logique maîtrisée du temps, je ressens des moments d’accélération ou de décélération, ou encore des moments suspendus. Je cherche dans mes œuvres des formes plastiques qui peuvent générer leur propre temps, de la même manière que certaines pratiques ont aujourd’hui révolutionné la relation homme-temps. Si l’on songe aujourd’hui au micro-trading par exemple, géré par des tonnes d’ordinateurs qui pratiquent le High Frequency Trading, on voit l’effet concret d’une technologie qui a bouleversé les places de marché. De nombreux pans de nos activités ne sont plus dans le temps classique du cadran de la montre, lui-même calé sur la course du soleil et la cloche de l’église…
G.C. : L’envisages-tu comme un matériau à part entière?
R.D.N. : Ce n’est pas un matériau comme les autres, mais plutôt à mon sens une source pour la pensée.
G.C. : Cette relation au temps nous entraîne inévitablement vers la science. Est-ce un domaine auquel tu t’intéresses ?
R.D.N. :Tout-à-fait. L’évolution de la science nous a montré qu’observer une chose était déjà une forme de modification de cette chose, et pour moi cela signifie qu’on ne peut envisager les évènements que dans leur succession, dans le déroulement, sans jamais pouvoir se fixer à aucun endroit.
G.C. : Pour ta première exposition personnelle à la Galerie Eric Mouchet, tu as notamment présenté une balance, qui fait référence à l’histoire industrielle de ta région : à ce temps très concret du travail et du monde ouvrier…
R.D.N. : Totalement, il s’agit avant tout d’une rencontre et des heureux hasards produits. J’ai monté un projet dans une usine de décolletage, un endroit où j’ai découvert beaucoup de rebuts, de déchets liés à une activité passée. Quand j’ai découvert cette balance, j’ai d’abord été marqué par son poids: elle était beaucoup plus lourde que ce qu’elle était censée mesurer elle-même! L’histoire du décolletage m’a intéressée, car à l’époque l’horlogerie Suisse n’a pas été capable de développer les technologies nécessaires, malgré ses richesses. Ce sont donc des paysans qui ont inventé par expériences successives ces technologies de pointe. Je me suis intéressé à ce glissement, qui part de grandes fortunes d’après-guerre axées sur un business de la mesure du temps, dont la conception a été confiée à des paysans. Cette pièce est donc une balance industrielle que je transforme en une sorte d’horloge. Elle ne peut que « peser le temps », grâce à son vérin hydraulique destiné à mesurer la pression, qui fait un bruit d’usure lié à son histoire dans l’usine. Ce son m’a tout de suite intéressé lorsque j’ai découvert cet objet et de fil en aiguille, j’ai développé ce système qui lui fait « peser » des secondes.
G.C. : De quoi s’agit-il ?
R.D.N. : J’ai développé un mécanisme à l’intérieur de la machine qui tire sur le vérin de façon autonome, puis ce mouvement est rendu manifeste grâce à un sytème de captation audio, dont le son est rediffusé dans la pièce d’à côté. J’y ajoute un delay qui lie ces secondes les unes aux autres dans une sorte de nappe sonore continue. J’ai travaillé avec l’école d’art d’Annecy sur le développement de ce projet qui faisait véritablement le lien avec toutes les pièces de l’exposition T*. J’aime l’idée que tout n’est pas donné, que les choses puissent vivre en dehors de moi et acquérir ainsi une autonomie dans leur rencontre avec le public.
G.C. : Beaucoup de tes pièces sont construites à l’aide de détournements de mécanismes existants, eux-même issus de systèmes, d’outils et d’instruments…
R.D.N. : C’est vrai, mais je ne prends jamais de mécanismes compliqués, toujours des systèmes très simples, très élémentaires. Lorsque j’utilise des outils électroniques ou logiciels, c’est à nouveau sur des opérations très simples, le plus souvent des bugs. Par exemple, la série des « Auras » vient d’une opération sur Adobe Illustrator où je demande au logiciel de vectoriser deux fois un trait. J’ai remarqué que dans la logique de ce logiciel, l’épaisseur d’un trait n’est ni de l’image, ni du vectoriel. Cette épaisseur de trait, c’est quelque chose que le programme ne peut vraiment traiter et je me suis donc amusé à jouer avec cette faille. Le programme « bug » en effet dès que tu lui demandes de revectoriser une forme déjà vectorielle. C’est là un geste mécanique très simple que j’applique de manière systématique et qui m’a permis de réaliser des centaines de motifs.
G.C. : Les portraits de Vivaldi (titre exact? Effigies ?) jouent un peu sur le même principe …
R.D.N. : En effet, la base du projet était d’utiliser des pédales d’effets appliquées à des gravures. J’ai découvert sur un site internet des portraits gravés de Vivaldi qui ne comportaient pas le nom du graveur, ce qui me laissait la place pour placer ma propre signature. J’ai donc détourné ces gravures originales en jouant sur différentes distorsions visuelles, équivalentes aux distorsions sonores : un déplacement du spectre sonore dans le champ de l’art visuel. Le choix de Vivaldi n’est pas anodin, c’est le compositeur qui est le plus souvent choisi pour l’habillage de l’espace, que l’on retrouve dans les ascenseurs, dans les halls d’aéroports, dans les lieux où il faut chasser le vide… C’est un compositeur qui est un peu dénigré en raison de cette application très grand public de sa musique. Il a été incroyablement prolifique, on redécouvre encore aujourd’hui des pièces de lui, et c’est aussi cette dimension très populaire qui m’a intéressée.
G.C. : T*, le titre de cette exposition, est assez singulier. Il est même difficile de savoir comment le prononcer… c’est un élément très précis de ta pratique photographique, peux-tu me l’expliquer?
R.D.N. : Oui, il s’agit d’un élément que les photographes utilisateurs de Zeiss vont tout de suite reconnaître, qui correspond à un type de traitement des objectifs qui se nomme le « multi coating ». Les revêtements sur le verre d’une optique peuvent modifier le piqué, le contraste et d’autres paramètres de la lentille. C’est pour moi un clin d’œil à mes rituels de photographe, qui est un autre aspect de ma pratique plastique. Cela renvoi au rythme de mes prises de vue : dès que j’ai l’intuition de pouvoir réaliser une photo, comme beaucoup de photographes, j’enlève le capuchon de l’objectif et je vois cette fameuse lettre et cette étoile sur l’objectif de mon appareil. J’ai eu l’idée de faire de ce petit motif marketing le titre de l’exposition, qui se donne comme un signe, un symbole, quelque chose de très visuel. En mathématique, ce « T » est la marque du temps et l’astérisque est la marque d’une sorte de suspension… J’invite le public à compléter ce « T », cette temporalité, ces déplacements d’images, tout comme je l’invite à se déplacer lui-même dans l’espace de l’exposition pour connecter les pièces.
G.C. : Quelles photos as-tu choisis de présenter ?
R.D.N. : Ce sont mes premières photos… J’aime exploiter les techniques que je ne connais pas. Tous les photographes ont une pratique très différentes. Pour ma part, ma particularité est qu’il m’est impossible de ne faire qu’une seule image de ce que je vois. Je suis obligé d’appuyer deux fois, avec des écarts de temps qui vont de une à dix secondes. Souvent, à la première photo, la personne ne me voit pas, mais c’est différent à la seconde. Je pratique ainsi mes prises de vue à la volée, en cherchant le bon angle et j’essaye d’être très rapide. Je m’intéresse à ce que produisent ces deux images dans un intervalle très court. Il y est question du temps de la photographie bien sûr. Dans l’exposition, j’ai essayé de faire en sorte qu’on ne puisse voir les deux photos en même temps, de les disposer dans l’espace de façon à ce qu’on doive se déplacer pour associer les deux images.
G.C. : Tu as aussi choisi de montrer des travaux issus de pratiques plus anciennes, qui mêlent la performance, le son, la sculpture…
R.D.N. : Oui, et notamment la performance avec la batterie (Titre?). Cette batterie, en tant qu’objet, m’a toujours beaucoup intéressé. C’est très mécanique : à la fois les articulations de l’objet lui-même mais aussi la mécanique des flux liée au déplacement de l’air à l’intérieur et rejetée à l’extérieur. Je me suis penché sur ces mouvements. Mon idée de départ était d’essayer de modifier l’espace avec du son, d’essayer « d’empocher » un son avec de la matière sonore. J’essaye de provoquer une transformation temporaire de l’espace qui, de fait, change temporairement la perception l’exposition.
La pièce consiste donc en une modification des peaux de frappe et des peaux de résonance de la batterie, que je rends entièrement rigides, grâce à des système de clapets anti-retour qui proviennent directement des systèmes d’aération des bâtiments. La vibration des peaux compresse l’air, qui est rejeté dans des manchons -des tubes- qui guident l’air dans des grandes bâches. Par ailleurs, nous utilisons un système d’amplification pour capter tous les petits bruits mécaniques des cerclages des peaux, mais aussi des cymbales, etc. La batterie devient ainsi vraiment autre chose, même en terme de sonorités. Les bâches sont posées en tas devant la batterie, et au fur et à mesure de la performance sonore, elles se déploient grâce à l’air injecté par la batterie, dans l’espace. Une fois que la bâche est gonflée, elle occupe naturellement une bonne partie de l’espace. Son volume correspond au volume d’air que nous avons « joué » en quelque sorte, comme si l’air contenu était le morceau lui-même. Les bâches se dégonflent ensuite lentement, comme si le son du concert quittait lentement l’espace de l’exposition : une certaine métaphore de l’ensemble de mes recherches…
Category:
Expositions
Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Vue de l’exposition T* – Rémi Dal Negro

Rémi Dal Negro, Compression, 2018, mousse acoustique, peinture, plexigalss, visserie, bois, 250 x 250 cm

Gare de Brest 3, tirage pigmentaire sur Dibon, 46 x 70 cm

Gare de Brest 4, tirage pigmentaire sur Dibon, 46 x 70 cm

Lans of Hopis 1, tirage pigmentaire sur papier Hanemuhle, 60 x 40 cm

Lans of Hopis 2, tirage pigmentaire sur papier Hanemuhle, 60 x 40 cm

Marseille Breakdance 1, tirage pigmentaire sur papier Hanemuhle, 80 x 53 cm

Marseille Breakdance 2, tirage pigmentaire sur papier Hanemuhle, 80 x 53 cm